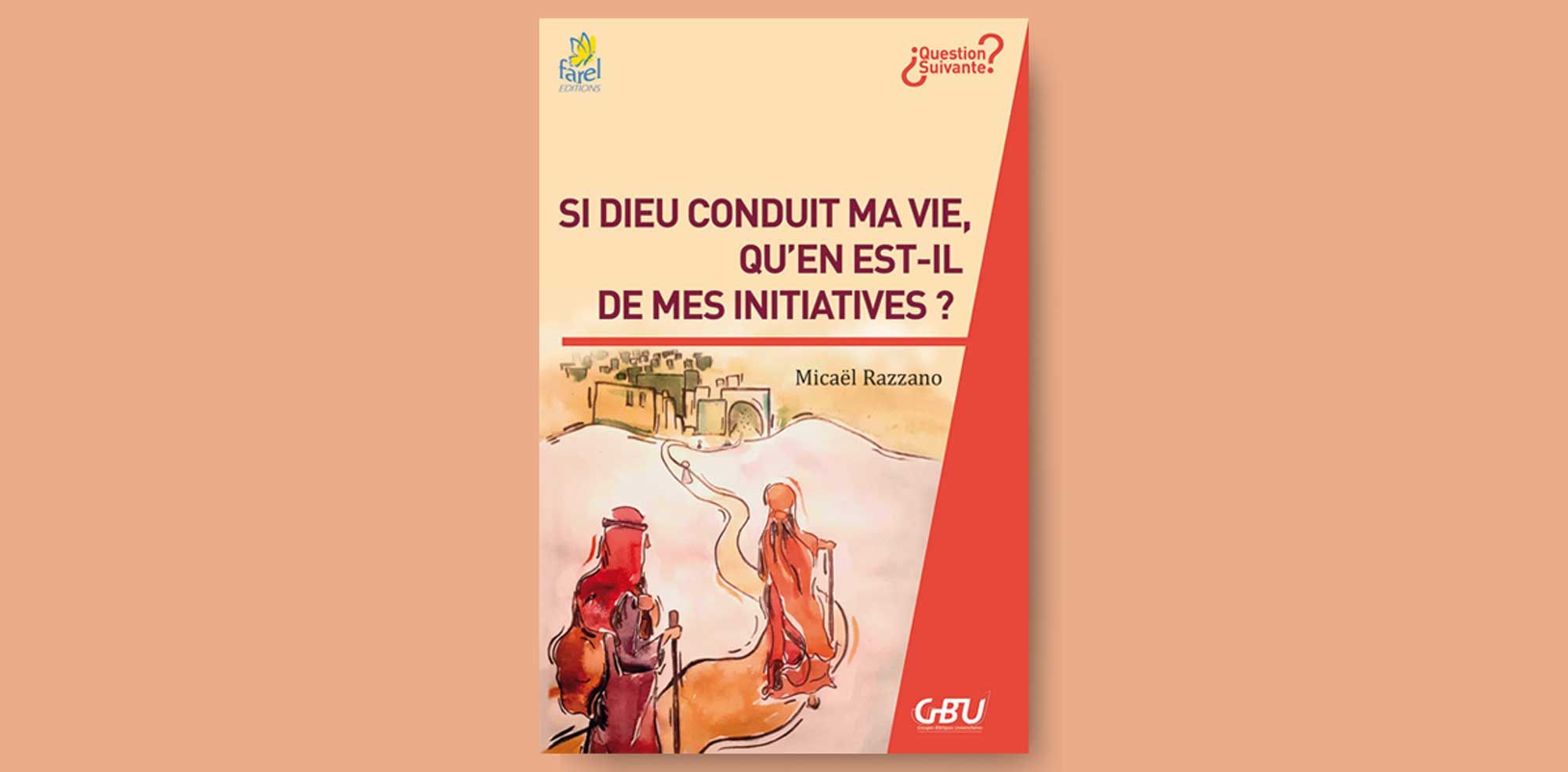Dieu vit que cela était bon

Le 30 Novembre 2021
Dieu vit que cela était bon
Organisé par le Carl Henry Center (Trinity Evangelical Divinity School, Illinois), ce colloque cherche à promouvoir la recherche théologique dans le domaine de la doctrine de la création qui soit à la fois fidèle aux convictions évangéliques et en interaction avec des travaux pertinents en sciences naturelles. Cette année, le colloque avait pour thème « Dieu vit que cela était bon : unir l’ordre naturel et moral ».
La bonté de la création est une affirmation centrale du premier chapitre de la Genèse, mais elle est souvent négligée dans les débats modernes sur les origines. D’une part, cette bonté est directement liée à la bonté de Dieu ; d’autre part, elle est opposée au péché et au mal. Les différents intervenants ont creusé la signification de la bonté de l’ordre naturel, et la question de savoir si les processus de l’évolution biologique, la souffrance et la mort animales seraient cohérents ou en opposition à cette affirmation. Une contribution particulièrement intéressante dans cette discussion venait d’un exposé de théologie biblique sur le mot tov (bon), dans le refrain du récit de la création : « Dieu vit que cela était bon ». On a suggéré que la création est bonne parce qu’elle accomplit le but pour lequel elle a été créée. Considérer ainsi la bonté change le regard porté sur le monde animal : peut-on vraiment considérer la chaîne alimentaire comme un mal et la conséquence du péché, si elle a été créée précisément pour ce but (cf. Ps 104.21) ?
Une particularité des colloques Dabar est leur déroulement : les articles sont distribués en avance et lors du colloque, chaque intervenant ne présente qu’un résumé de son article, suivi de deux répondants qui soulèvent les points forts et faibles de son argumentation. Cela laisse un temps significatif pour des questions et la réflexion se poursuit dans les groupes de discussion. Ce format a beaucoup plu à notre groupe francophone, puisque le travail de préparation en amont a généré des échanges riches et approfondis, et nous a permis d’avancer dans cet important débat.
Rachel VAUGHAN